Histoire de la Palestine #9
Le sionisme a effacé la Palestine de la carte...

La Résistance Palestinienne : Un Peuple Face aux Puissances Mondiales (1917-1939)
Depuis les débuts de l’idée sioniste du "retour" des Juifs en Palestine jusqu’à aujourd'hui, l’histoire de la Palestine est marquée par une résistance constante de son peuple.
Face à la colonisation britannique et à l’établissement d’un foyer national juif, les Palestiniens ont déployé diverses formes de lutte, allant de la résistance pacifique à l’insurrection armée qualifiée de terrorisme par l'occupation.
La Résistance Pacifique : Mobilisation Politique et Juridique
Dans un premier temps, la résistance palestinienne s’est manifestée par des moyens pacifiques, politiques et légaux. Cette approche visait à utiliser les principes et les lois britanniques pour défendre la cause palestinienne et à exercer une pression sur les autorités mandataires.
L’objectif était de mettre les Britanniques face à leurs propres contradictions et de les inciter à respecter les droits du peuple palestinien en utilisant les institutions qu’ils avaient eux-mêmes créées.
Cette forme de résistance, typique des peuples en situation de faiblesse et dépourvus de force militaire, comprenait une série de congrès arabes dont les revendications principales étaient l’annulation de la Déclaration Balfour, l’arrêt de l’immigration juive et de la vente de terres aux Juifs, ainsi que la demande de création d’un conseil législatif représentant les Palestiniens, auquel émanerait un gouvernement palestinien.
Le premier de ces congrès s’est tenu à Jérusalem en 1919 et affirmait l’appartenance de la Palestine à une Syrie unie sous un régime arabe plus vaste.
Cependant, la volonté des puissances occidentales et la situation politique des dirigeants arabes de l’époque ont rendu ces aspirations difficiles à concrétiser.
Sept congrès se sont ainsi succédé jusqu’en 1928, sous la direction de Moussa Kazim al-Husseini, considéré comme le principal dirigeant politique palestinien jusqu’à son décès en 1934.
En réaction à son influence, les Britanniques ont créé le poste de Mufti de Jérusalem et de président du Conseil Islamique, nommant à cette fonction Amin al-Husseini, un membre de sa famille. Si Amin al-Husseini a initialement montré une certaine modération envers les Britanniques, il est ensuite devenu une figure centrale et incontestée de la résistance palestinienne.
La dimension islamique était prédominante dans cette résistance, avec le Mufti Haj Amin al-Husseini s’appuyant sur son prestige religieux et le réseau des institutions islamiques (wakfs, tribunaux religieux, imams, prédicateurs et écoles coraniques) pour mobiliser la population contre l’occupation britannique ....
Malgré ces efforts, la résistance pacifique a montré ses limites. L’échec de la visite de Moussa Kazim al-Husseini et d’une délégation arabe à Londres en 1930, ainsi que la lettre du Premier ministre britannique MacDonald à Chaim Weizmann réaffirmant l’engagement de la Grande-Bretagne envers le sionisme (connue sous le nom de Livre Blanc pour les Palestiniens), ont révélé la détermination britannique à poursuivre sa politique.
Bien que les activités pacifiques se soient poursuivies, notamment le Congrès Islamique Général de 1931 à Jérusalem, qui a réuni des personnalités importantes du monde musulman et a pris des décisions telles que la création d’une université islamique et d’une société pour sauver les terres palestiniennes, leur impact sur le cours du conflit restait limité.
En 1935, un congrès de savants palestiniens a émit une fatwa interdisant la vente de terres aux Juifs, soulignant la gravité de la situation.
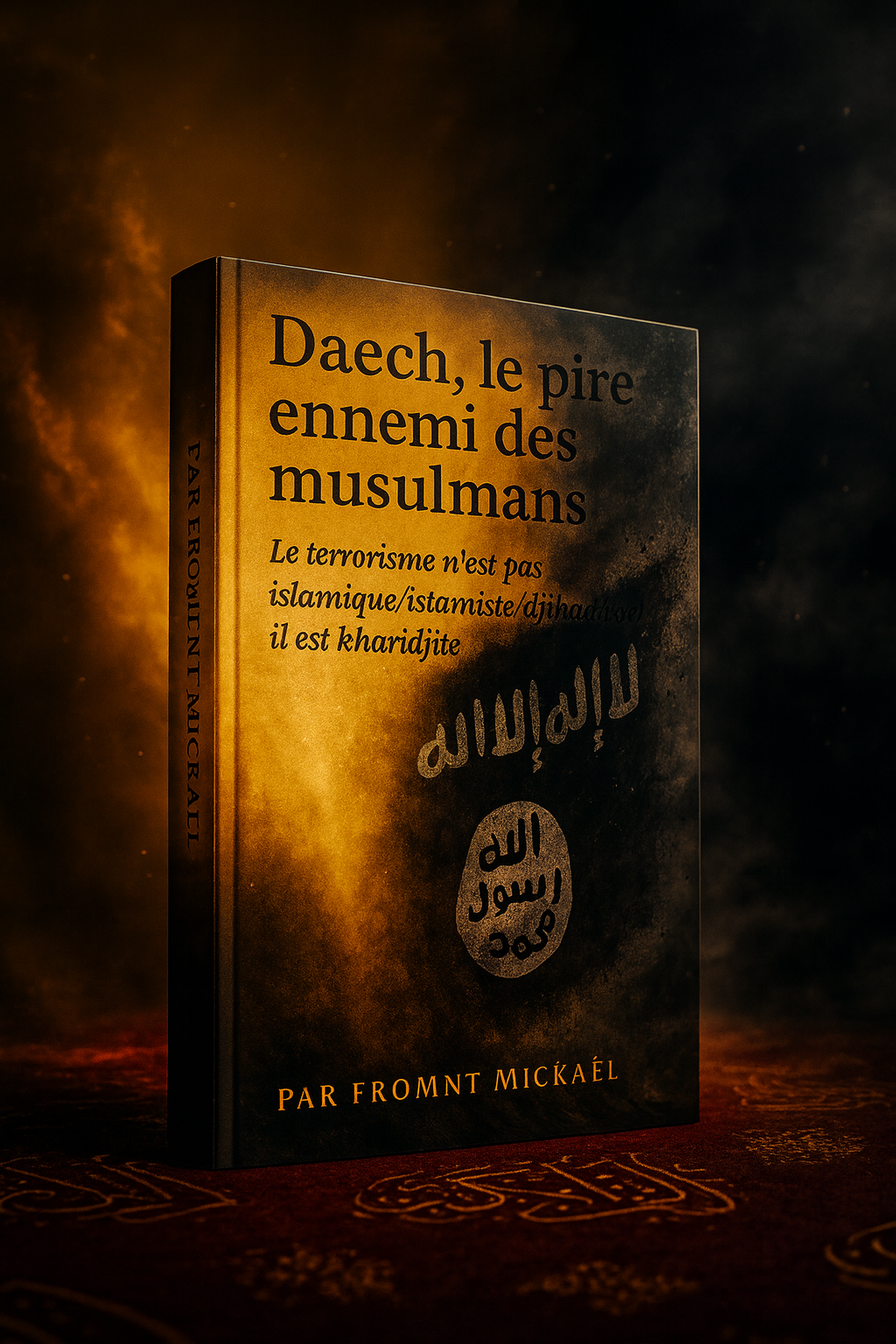
La politique britannique consistait également à manipuler les élites palestiniennes, en favorisant certains et en marginalisant d’autres, afin de diviser le mouvement national et d’affaiblir toute tentative d’unité et de représentation politique.
Certains notables, qualifiés de « nationalistes domestiqués » par certains chercheurs, ont pu être cooptés par l’occupant en échange de privilèges et de positions.
Historiquement, le Passage à la Résistance Armée : Les Premières Étincelles
Face à l’impasse de la résistance pacifique et à la montée en puissance du projet sioniste, une résistance armée, qualifiée paradoxalement de terrorisme par le sionisme qui génocidé des villages entiers de civils innocents, a commencé à émerger.
Malgré la dureté de l’occupation britannique, les Palestiniens n’ont pas cessé de résister par tous les moyens possibles.
Une série d’intifadas ont éclaté, ciblant principalement la population juive, perçue comme la principale menace, tout en évitant une confrontation directe avec la puissance britannique.
Ces soulèvements, tels que ceux de Jérusalem en 1920, de Jaffa en 1921, de Buraq en 1929 et de Jérusalem et Jaffa en 1933, avaient un caractère islamique. Bien que les pertes soient relativement équilibrées entre Arabes et Juifs, il est important de noter, dans le contexte de cette époque, que les Arabes étaient souvent tués par les forces britanniques avec des armes à feu, tandis que les Juifs étaient tués par des moyens plus rudimentaires utilisés par les Arabes.
Des initiatives individuelles et des petits mouvements armés ont également vu le jour, à l’image de marins de Jaffa qui ont fait exploser des bombes sur des navires transportant des immigrants juifs ou du mouvement « La Main Verte » dirigé par Ahmed Tafish.
Ces mouvements, souvent rapidement réprimés, marquaient une évolution vers une confrontation directe avec les deux ennemis : les sionistes et les Britanniques, considérés par certains comme la source du problème.
La Figure du Cheikh Izz ad-Din al-Qassam et les Prémices de la Grande Révolte
La période 1930-1935 a été cruciale en raison de la croissance significative de la présence juive en Palestine sur les plans économique, migratoire, financier et politique.
C’est dans ce contexte qu’émerge la figure du Cheikh Izz ad-Din al-Qassam, qui a prôné une révolution armée contre les Britanniques.
Malgré le scepticisme des dirigeants palestiniens de l’époque, qui estimaient que le peuple n’était pas encore prêt, Cheikh Izz ad-Din al-Qassam a lancé sa révolte en 1935 et a été tué au combat en novembre de la même année.
Son organisation, clandestine et principalement active dans le nord de la Palestine, rassemblait entre 200 et 800 membres et insistait sur la préparation au jihad armé, exigeant de ses recrues qu’elles achètent leurs propres armes ....
Le mouvement ciblait les Juifs, les Britanniques, ainsi que les espions et collaborateurs, et fonctionnait selon une structure organisationnelle « en grappe » pour assurer sa sécurité.
Après son martyre, son compagnon, le Cheikh Farhan al-Sa’di, a pris la relève.
Un événement à Haïfa, où des habitants ont découvert que des caisses destinées à des commerçants juifs contenaient des armes et des munitions au lieu de marchandises, a contribué à accélérer le sentiment d’urgence et la nécessité de s’armer au sein de la population palestinienne.
Le mouvement de Cheikh Izz ad-Din al-Qassam était majoritairement composé de religieux musulmans et n’a reçu aucun soutien des régimes arabes de l’époque. Même les notables palestiniens n’ont pas participé à ses funérailles par crainte de représailles britanniques.
À Jérusalem, une autre organisation armée dirigée par Abd al-Qader al-Husseini, bénéficiant du soutien de Haj Amin al-Husseini, comptait environ 400 membres en 1935.
La Grande Révolte Palestinienne (1936-1939)
Le martyre de Cheikh Izz ad-Din al-Qassam a eu un retentissement considérable dans le monde arabe et a déclenché la Grande Révolte Palestinienne de 1936-1939, également connue sous le nom de Révolution Rurale Palestinienne ou de Grande Grève.
Cet événement a été précédé par deux autres facteurs : l’annulation par les Britanniques d’un projet de formation d’un parlement en Palestine et le succès d’une grève générale en Syrie qui avait contraint la France à former un gouvernement national. Ces éléments ont créé un climat propice à l’insurrection.
L’étincelle de la révolte a été une opération menée par les partisans de Cheikh Izz ad-Din al-Qassam, dirigés par Farhan al-Sa’di, le 15 avril 1936.
Les représailles mutuelles ont rapidement conduit à une grève générale déclenchée le 20 avril 1936, qui a duré six mois, devenant ainsi la plus longue grève de l’histoire de la Palestine et, selon certains historiens, la plus longue grève menée par un peuple entier.
Sur le plan politique, les partis arabes palestiniens se sont unis pour former le Haut Comité Arabe le 25 avril 1936, sous la direction de Haj Amin al-Husseini.
Le Comité a présenté des revendications pour mettre fin à la grève : la formation d’un gouvernement palestinien responsable devant un parlement élu, l’arrêt de l’immigration juive et l’arrêt de la vente de terres aux Juifs.
Face à cette situation, la Grande-Bretagne a usé de répression violente et de manœuvres politiques pour briser la grève.... Elle a notamment fait pression sur les dirigeants arabes sous son influence pour qu’ils interviennent auprès du Haut Comité Arabe et a annoncé l’envoi d’une commission d’enquête de haut niveau, la commission Peel.
Sous cette double pression, les Palestiniens ont mis fin à la grève après six mois, dans l’espoir que les efforts politiques arabes et britanniques porteraient leurs fruits.
Cependant, la commission Peel, dont le rapport a été publié en juillet 1937, a proposé pour la première fois le partage de la Palestine entre Arabes et Juifs, une proposition choquante qui octroyait aux Juifs, qui possédaient alors environ 5 % des terres, près d’un tiers du territoire, tout en laissant deux tiers aux Arabes et en plaçant une zone stratégique sous mandat britannique direct.
Cette proposition, perçue comme une victoire significative pour le projet sioniste, a exacerbé la colère du peuple palestinien et a conduit à une reprise de la révolte.
En réponse, la Grande-Bretagne a déclaré la dissolution du Haut Comité Arabe, a arrêté plusieurs de ses dirigeants et les a exilés aux Seychelles. Amin al-Husseini a réussi à s’échapper et à se réfugier au Liban.
Sur le plan militaire et sur le terrain, la révolte a ciblé les collaborateurs, les espions, les Britanniques, les colonies juives, les responsables britanniques, les policiers arabes travaillant pour l’administration britannique, ainsi que les infrastructures de transport et de communication utilisées par les forces britanniques (ponts, voies ferrées, lignes téléphoniques, oléoducs).
L'Histoire remémore que l’apogée de ces actions a été l’assassinat du gouverneur britannique Lewis Andrews le 26 juillet 1937, quatre jours après la publication des conclusions de la commission Peel.
Durant l’été 1938, les révolutionnaires ont réussi à prendre le contrôle de la majeure partie de la campagne palestinienne et même de certaines villes pour des périodes limitées.
La résistance palestinienne (qualifiée de terrorisme par le sionisme politique qui pratiquait l'épuration ethnique de villages palestiniens) dans ses formes pacifiques et armées, témoigne de la détermination d’un peuple à défendre sa terre et son identité face à des défis considérables et à des puissances mondiales ....
La Grande Révolte de 1936-1939, bien que réprimée, a marqué une étape cruciale dans l’histoire de la lutte palestinienne pour l’autodétermination.
Soutenez la rédaction d'articles, de PDF, de livres, de vidéos ainsi que les abonnements que sont l'hébergement, Chatgpt, canva... Sans vous l'aventure serait impossible. Vos soutiens sont primordiaux pour la continuité du projet. Doua.



